
Des mots qui blessent, des idées qui menacent
Il ne s’agit pas seulement de dérapages. Ni de maladresses isolées. La misogynie s’exprime au sommet de l’État, dans des discours, des décisions politiques, des lois. Elle se banalise, se justifie, se revendique. Et ses effets sont concrets : recul des droits des femmes, légitimation des violences, montée de la haine sexiste.
Quand les chefs d’État s’autorisent la haine
Donald Trump (États-Unis)
Le président américain a été l’un des symboles les plus visibles de cette dérive.
- Ses propos sur les femmes (« Grab them by the pussy », « un 4 ou un 5 sur 10 », etc.) sont devenus tristement célèbres.
- Il a remis en cause les mouvements féministes, rabaissé les femmes journalistes, moqué les victimes de violences sexuelles.
- Sous sa présidence, des mesures ont été prises pour restreindre l’accès à l’avortement et affaiblir les protections anti-discrimination.
Trump n’a pas seulement tenu des propos sexistes. Il incarne une idéologie où le pouvoir masculin s’affirme par le mépris des femmes.
Vladimir Poutine (Russie)
Le président russe affiche un discours viriliste assumé :
- glorification du “mâle fort”,
- retour à une vision “traditionnelle” de la famille,
- rejet des mouvements féministes qu’il qualifie de “décadents”.
En 2017, la Russie a partiellement dépénalisé les violences domestiques, les réduisant à de simples délits si elles ne causent pas d’hospitalisation. Ce choix politique envoie un message clair : la violence dans le couple n’est pas une priorité.
Des exemples partout dans le monde
Ce phénomène n’est pas isolé. On le retrouve ailleurs, parfois sous des formes plus subtiles :
- Jair Bolsonaro (Brésil) : propos violents contre les femmes (“elle ne mérite pas d’être violée”, “les femmes doivent gagner moins car elles tombent enceintes”).
- Recep Tayyip Erdoğan (Turquie) : rejet des conventions sur les violences faites aux femmes, discours pour renvoyer les femmes à “leur vraie place : la maternité”.
- Viktor Orbán (Hongrie) : politique anti-genre, attaques contre les droits sexuels et reproductifs, exaltation d’un modèle familial patriarcal.
- Silvio Berlusconi (Italie, décédé) : objectification constante des femmes, scandales liés à la prostitution de mineures, et pourtant resté populaire pendant des années.
Pourquoi c’est grave
Quand des figures de pouvoir tiennent des propos sexistes, misogynes ou rétrogrades, cela :
- légitime les violences faites aux femmes ;
- délégitime la parole des victimes ;
- renforce les stéréotypes de genre ;
- donne du poids aux mouvements masculinistes ;
- affaiblit les lois protectrices.
Ces discours ne sont pas des opinions parmi d’autres. Ils construisent une culture politique où la violence faite aux femmes est normalisée.
La misogynie politique, un outil de domination
La haine des femmes sert souvent à consolider une idéologie autoritaire. En s’en prenant aux droits des femmes, ces régimes affirment leur contrôle sur le corps, la parole, l’autonomie.
La misogynie politique n’est pas une erreur de communication. C’est une stratégie. Une arme. Un projet.
Résister, nommer, dénoncer
Face à cela, nous devons continuer à observer, à nommer, à décrypter. Car ce qui se joue dans les discours influence nos vies quotidiennes. Et parce que les mots qui blessent aujourd’hui peuvent justifier les violences de demain. Refuser la misogynie politique, c’est défendre les droits humains. C’est protéger les libertés de toutes et tous. C’est dire : nous voyons. Nous savons. Et nous ne laisserons pas faire.
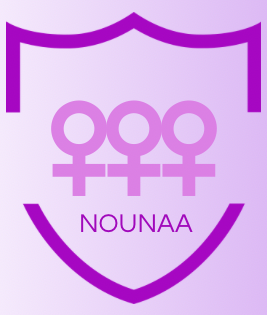

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.